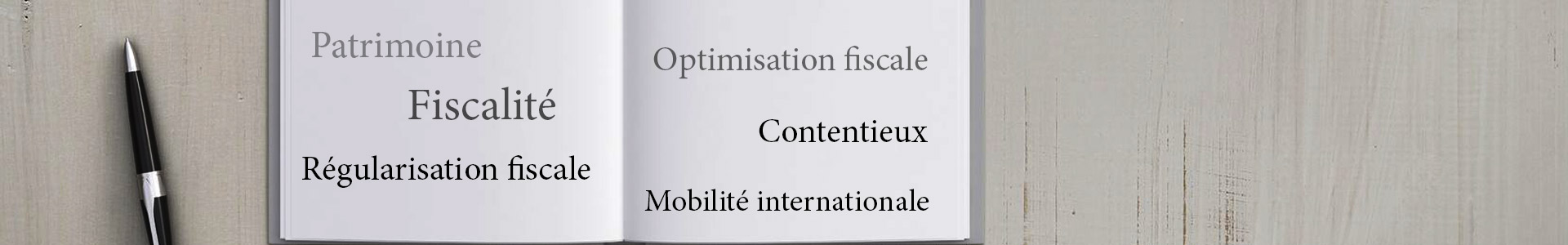Société étrangère taxable en France : Du bon usage de la jurisprudence Artémis
(CE 25 juillet 2025, n° 489925)
On sait depuis l’arrêt Artémis SA du 24 novembre 2014 (n° 363556) que lorsqu’il est confronté à une structure sociétaire étrangère par définition inconnue du droit français, le juge de l’impôt doit impérativement tenter, en analysant les caractéristiques propres de cette structure, de la rattacher à une forme connue du droit français.
L’exercice n’est pas évident et dans la décision commentée, le Conseil d’Etat se livre à une piqûre de rappel quant à la méthodologie que doivent suivre les juges du fond. Il s’agissait en l’espèce d’une société de droit britannique intitulée « private limited company by shares », que les premiers juges, suivis par la Cour Administrative d’Appel de Marseille, avaient qualifiée de SARL et, comme elle avait un unique associé, d’EURL. Cette qualification lui avait permis d’obtenir le dégrèvement de la retenue à la source de l’article 119 bis du CGI puisqu’une EURL dont l’associé unique est une personne physique n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés mais est fiscalement translucide.
Le Conseil d’État valide la conclusion – c’est bien assimilable à une EURL – mais pas le raisonnement. En effet, les juges du fond avaient écarté l’autre assimilation possible – que revendiquait le fisc – à la SASU (la forme unipersonnelle de la Société par Actions Simplifiée) en se fondant sur le fait qu’en l’espèce, le certificat d’enregistrement de la private limited company by shares prévoyait que chaque share correspondait, le cas échéant, à une voix et à un dividende égal, à la différence des SAS qui peuvent émettre des actions de préférence en vertu des articles L. 227-1 et L. 228-11 du Code de Commerce. Le Haut Tribunal estime que l’émission d’actions de préférence n’étant qu’une faculté offerte par les statuts, l’absence d’émission de telles actions ne saurait constituer le facteur discriminant recherché.
Jugeant alors l’affaire au fond, il identifie le bon critère pour qualifier la société étrangère. Il commence par partir du certificat d’enregistrement qui mentionne qu’elle a adopté partiellement les statuts-types (« model articles ») prévus pour les sociétés relevant du statut de « private company limited by shares » et il observe ensuite que ses statuts particuliers, accessibles sur la base des données publiques britanniques, reproduisent des stipulations types, insusceptibles pour certaines d’entre elles de régir, en termes de constitution et de fonctionnement, la situation d’unicité d’associé qui la caractérise au cours des exercices et des années en litige. Il en conclut que l’adoption de tels statuts types révèle ainsi que la société n’a pas été constituée à l’aune de la liberté statutaire caractéristique des SAS de droit français, de sorte qu’elle ne peut être assimilable qu’à une SARL.
Le bon critère ici est donc celui tiré de la souplesse que le droit local offre à la liberté contractuelle qui s’exprime dans les statuts, par opposition au poids important des règles légales impératives qui limitent cette liberté. Évidemment, lorsque l’hésitation concerne d’autres types de structure, le bon critère sera différent.
Quelle portée peut bien avoir cette décision sur la fiscalité du patrimoine qui nous intéresse au premier chef ? Une portée importante, car les institutions étrangères inconnues du droit français comprennent aussi les trusts. Or, si le droit français ignore le trust, il connaît en revanche la fiducie et dans certaines hypothèses, un trust étranger paraît tout à fait assimilable à une fiducie. C’est en particulier le cas des fameux living trusts constitués aux USA pour contourner la règle du probate et faciliter l’entrée en possession d’un compte bancaire par les héritiers de son titulaire. Le raisonnement du Conseil d’Etat pris en sa formation de jugement semble donc aller directement à l’encontre de celui de sa section des Finances (18 avril 2023, Avis n° 406825), qui considère ces trusts comme opaques pour l’application de la convention fiscale franco-américaine.
Certes, l’article 120 du CGI répute le trust comme étant opaque, mais quel trust vise-t-il ? Celui qui ressemble comme deux gouttes d’eau à une fiducie ou celui qui ne peut pas y être assimilé ? La réponse finira bien par tomber…