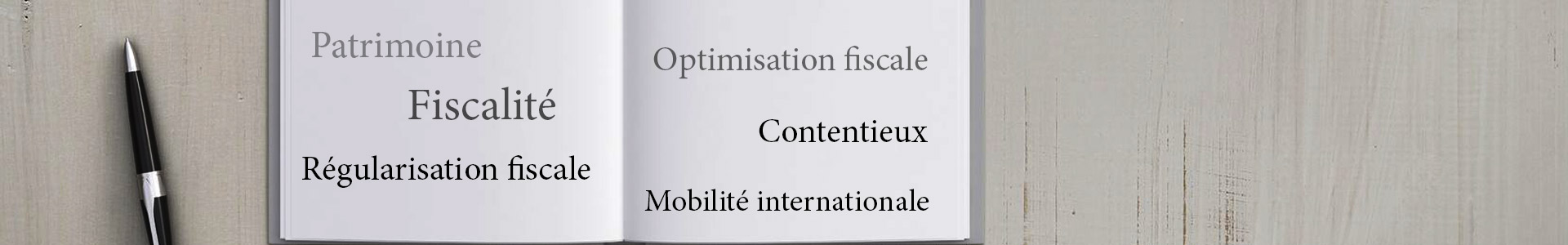Taxation des actifs financiers des holdings patrimoniales : Un chef d’œuvre technocratique aux pieds d’argile ?
(Article 3 du projet de loi de finances pour 2026)
La sagesse populaire sait bien qu’en France, on sème des fonctionnaires et on récolte des impôts. A l’heure où la trajectoire de nos finances publiques se rapproche dangereusement du mur de la Dette, les fonctionnaires de Bercy ont pu d’autant plus débrider leur imagination pour trouver de nouvelles ressources qu’à défaut de recettes fiscales nouvelles, il n’est pas dit qu’ils ne seraient pas également impactés par les économies à faire.
Avec la prorogation d’un an de la Contribution Différentielle sur les Hauts Revenus (qui risque bien, si elle est effectivement maintenue, par devenir aussi « exceptionnelle » que sa grande sœur la CEHR instaurée en 2011 juste le temps nécessaire pour respecter les critères de Maastricht…), l’autre mesure proposée pour « faire payer les riches » (pardon : faire mieux participer les plus fortunés à l’effort de redressement de nos finances publiques) confine au chef d’œuvre : une taxe de 2 % sur le patrimoine financier présumé excédentaire (donc non nécessaire) des holdings patrimoniales.
L’instauration de cette taxe au niveau de la société elle-même vise à contourner l’écueil constitutionnel résultant de la jurisprudence constante du Conseil Constitutionnel relative au principe d’égalité devant les charges publiques (article 13 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789), qui interdit, sauf cas de fraude, de taxer un revenu non réalisé (v. notamment Décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013 sur l’article 13 de la loi de finances pour 2014 en matière de plafonnement de l’ISF). Et effectivement, il n’y a (presque) rien à redire au principe de l’instauration d’une telle taxe qui va juste impacter la rentabilité des placements financiers des sociétés concernées (si ce n’est son taux sur lequel nous reviendrons)
Là où l’affaire se corse, c’est lorsque la société patrimoniale n’est pas située en France. Comment faire pour la taxer alors que par définition, elle est hors du champ de la fiscalité française des sociétés ? C’est effectivement impossible, dont acte. Mais nos fonctionnaires proposent de contourner l’obstacle en taxant directement les associés personnes physiques résidant en France. Et c’est à ce stade que diverses questions de compatibilité de la taxe avec les normes supérieures se posent.
Les normes constitutionnelles, avec l’article 13 de la DDHC déjà mentionné. Il est certes exact que le principe d’égalité devant les charges publiques n’interdit pas de traiter différemment des situations différentes. Encore faut-il que les situations soient réellement différentes. Or, rien ne distingue du point de vue de l’associé une société établie en France d’une société établie à l’étranger. Ce dernier est en effet soumis à la même fiscalité sur ses dividendes, ses plus-values et sa fortune (l’Impôt sur la Fortune Immobilière et les droits de mutation à titre gratuit).
En revanche, avec cette taxe nouvelle qui ne comporte aucune mesure de plafonnement (et pour cause !), il va devoir, pour l’acquitter, mobiliser ses actifs financiers personnels. Or, lesdits actifs ont été acquis avec des fonds ayant eux-mêmes supportés l’impôt sur le revenu.
Un petit exemple très simple nous permettra de bien comprendre. Pour financer la taxe de 2 %, l’associé décide de se distribuer un dividende de sa société. Ce dividende supportera l’impôt local plafonné à 15 %, puis l’impôt français sur les revenus mobiliers (la flat tax de 30 % éventuellement majorée de la CEHR et la CDHR, soit une taxation maximale de 37,2 %) sur lequel l’impôt étranger formera crédit d’impôt. Ce n’est donc pas 2 % que lui coûtera effectivement cette taxe, mais 2 % + 37,2 % de son montant calculé au taux en-dedans, soit un total de 3,18 %.
Il est probable que le Conseil Constitutionnel, s’il est saisi de cette mesure, ne trouve la marche un peu haute pour considérer que le contribuable qui est associé d’une société étrangère visée par la mesure ne subit aucune discrimination par rapport au même contribuable associé d’une société identique mais française.
D’autant plus que même avec un taux de 2 % à la charge de la société, l’imposition du patrimoine financier confine à la spoliation pure et simple : comme l’Etat emprunte aujourd’hui à 10 ans à 3,3 %, la société qui aura placé ses fonds sur un tel placement réputé sans risque supportera néanmoins sur ses revenus financiers son impôt sur les sociétés au taux de 25 %. Autant dire qu’après l’impôt sur les sociétés et la taxe de 2 %, le taux effectif de l’imposition globale subie par la société s’établira à 75 % du produit de ses placements sans risque, alors pourtant qu’une imposition sur le patrimoine doit pouvoir être acquittée par les revenus dudit patrimoine.
Là encore, l’article 13 de la DDHC tel qu’interprété par le Conseil Constitutionnel (par exemple, la décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 sur les retraites-chapeau et la décision n° 2012-654 DC sur la Contribution Exceptionnelle sur la Fortune) devrait venir en aide aux contribuables concernés. On notera en passant que pour les associés de structures étrangères visées par le texte, la spoliation est totale puisqu’entre l’impôt sur les sociétés, l’impôt de distribution et la taxe de 2 %, on dépasse les 100 % d’impôts cumulés sur les revenus des placements sans risque.
Mais ce n’est pas tout : avec un tel régime, quel contribuable résident français va constituer à l’étranger une société susceptible d’entrer un jour dans le champ de ce texte ? Et tous ceux qui en détiennent une ne seraient-ils pas plus qu’incités à la rapatrier en France ? Il est peu probable que la Commission Européenne ou la jurisprudence ne valide une telle entorse à la liberté communautaire de circulation des capitaux.
Et quelle pourrait être la sanction d’une telle violation ? On sait que la jurisprudence française considère que le droit interne reste valide dans la mesure de sa non-contrariété avec le droit communautaire, ce qui a permis au Conseil d’Etat de maintenir la taxation de la quote-part de frais et charges sur les plus-values de cession de participations dans des sociétés françaises par des sociétés étrangères (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2022/12/article-244-bis-b-du-cgi-et-liberte-de-circulation-des-capitaux-revirement-de-jurisprudence/). Mais ici, c’est la taxe totale dont les contribuables concernés devraient obtenir le dégrèvement. Ce qui en passant aboutirait pour le coup à une discrimination par ricochet au détriment des sociétés françaises qui auront supporté cette taxe dont on sera curieux de savoir comment nos juges – qui n’ont apparemment plus rien contre les discriminations à rebours depuis le revirement de jurisprudence du Conseil Constitutionnel (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2020/04/echec-de-nos-qpc-sur-lapplication-des-abattements-pour-duree-de-detention-aux-plus-values-en-report/) – réagiront lorsqu’ils seront confrontés aux effets de bord induits par ces diverses violations des normes supérieures.
Avec cette mesure, nous entrons dans une période passionnante qui nous rappelle les diverses tentatives du législateur pour torpiller nos stratégies de plafonnement de l’ISF évoquées plus haut et dont nous étions sortis à l’époque gagnants. Bis repetitam non placent ?