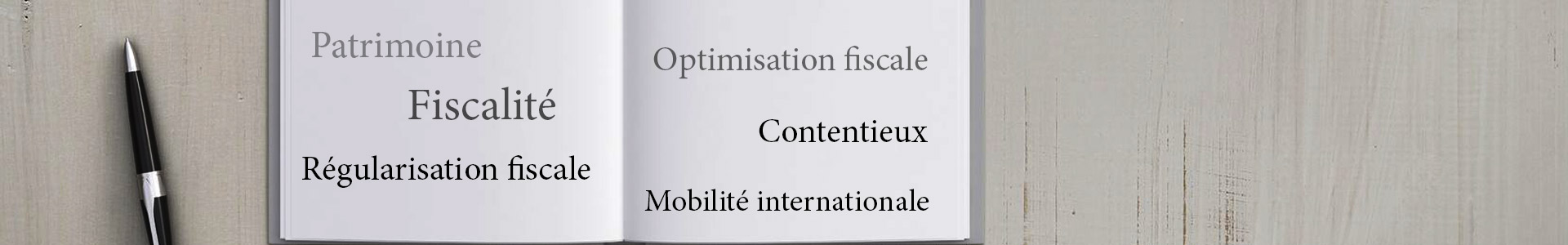Carte des Schémas Abusifs : Bercy cible l’usage du trust
La fameuse carte des schémas abusifs mis en ligne par l’administration fiscale s’est récemment enrichie de plusieurs schémas, dont un seul retiendra notre attention : celui intitulé « Prêts fictifs visant à dissimuler les revenus d’un trust ».
Le schéma dénoncé a fait l’objet d’un avis favorable à l’administration du Comité de l’Abus de Droit Fiscal (Affaire n° 2022-01) et comme à l’accoutumée, le fisc recommande aux personnes se trouvant dans la même situation de prendre son attache pour se mettre en conformité. Pour notre part, nous leur recommandons plutôt, avant de songer aller à Canossa la tête couverte de cendres et la corde autour du cou, d’attendre l’issue du contentieux que nous avons engagé pour la défense de notre client et qui est actuellement pendant devant le tribunal administratif de Paris. En effet, dans cette affaire, tant l’administration que le Comité ont fait preuve d’une méconnaissance totale de la nature juridique d’un trust discrétionnaire et irrévocable.
Les faits de l’affaire étaient les suivants : le contribuable avait créé un trust discrétionnaire et irrévocable lorsqu’il était résident fiscal britannique pour y recevoir – en toute légalité – les carried interests que pouvait lui procurer son activité de gestionnaire d’un fonds d’investissement. Il s’est installé ultérieurement en France pour y poursuivre la même activité puis a quitté son employeur et décidé de lancer une activité d’hôtellerie et de viticulture. L’essentiel de ses avoirs étant dans son trust qui s’était entretemps considérablement enrichi des carried interests qu’il y avait mis, il n’y avait pas accès compte tenu du caractère irrévocable du trust. Plutôt que de financer ses nouvelles activités avec l’aide de banques, il a préféré demander au trustee – une société internationale ayant pignon sur rue et non une officine à sa main – qu’il lui prête les fonds nécessaires. Après examen des projets, le trustee a accepté de les financer au moyen de prêts avec intérêts qui ont été enregistrés (comme l’existence du trust a été déclarée au fisc quand la loi de 2011 est entrée en vigueur). Pour cela, il a utilisé les fonds d’une société de droit britannique qu’il avait constituée et à laquelle il avait apporté une partie des fonds en trust pour les gérer.
Malheureusement, les investissements ont tourné au fiasco et le contribuable s’est trouvé dans l’impossibilité de payer les intérêts. Il a même dû commencer à liquider son patrimoine pour rembourser sa dette au trustee. Un malheur n’arrivant jamais seul, il a fait l’objet d’un ESFP au cours duquel l’administration a contesté – jusqu’ici avec succès – la réalité des prêts obtenus du trustee, qu’elle a requalifiés en distribution du trust et taxés en revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l’article 120 9° du CGI.
Selon elle et le Comité, l’interposition de la société britannique – qui n’était qu’une simple coquille – comme prêteuse des fonds du trust ne visait qu’à dissimuler la distribution de produits par le trust au profit de son constituant et principal bénéficiaire. Il semble donc que ce soit l’interposition de cette société – elle-même réputée dépourvue de substance – qui aurait constitué le facteur impulsif et déterminant de la requalification.
Pourtant, les reproches faits au contribuable manquent singulièrement de fondement au regard du droit des trusts.
D’abord, sa qualité de constituant est totalement inopérante s’agissant d’un trust irrévocable. C’est seulement en sa qualité de bénéficiaire qu’il a pu demander au trustee l’octroi des prêts litigieux. Or, il n’était certainement pas le « principal bénéficiaire » du trust, mais un bénéficiaire parmi d’autres aux côtés de son frère, son épouse et ses enfants.
Ensuite, il n’a certainement pas été à l’origine de la création de la société interposée, puisque c’est le seul trustee qui a jugé utile pour ses affaires, dans le cadre de ses pouvoirs, de la constituer puis d’utiliser les fonds qu’il y avait apportés pour consentir les prêts litigieux. On peut d’ailleurs s’étonner de la qualification d’absence de substance donnée à cette société, puisque son rôle consistait précisément à gérer les fonds apportés par le trustee et leur octroi sous forme de prêt paraît parfaitement conforme à cet objet.
Enfin, l’octroi des prêts comme leurs conditions (intérêts, garanties, etc.) relèvent dans un trust discrétionnaire de la seule responsabilité du trustee, qui aurait d’ailleurs parfaitement pu refuser de les accorder et qui devra en tout état de cause les justifier auprès des bénéficiaires du trust sous le contrôle du juge. Nul doute que dans cette affaire, le trustee aura un jour des comptes à rendre à ces derniers s’il ne parvient pas, comme c’est probable, à obtenir le complet remboursement de sa créance. A moins qu’il ne décide souverainement – et comme c’est son droit – de distribuer au débiteur le solde de la créance non remboursée (et non remboursable), opération qui emportera d’ailleurs des conséquences fiscales pour ce dernier, qui dépendront toutefois de l’issue de son contentieux car il n’est pas question qu’il paye deux fois l’impôt de distribution.
Pour conclure, les faits de cette affaire apparaissent tellement spécifiques qu’il nous semble en tout état de cause difficile d’y voir un « schéma abusif » qui aurait sa place dans la cartographie établie par Bercy. Tant que le juge de l’impôt ne se sera pas prononcé, il nous paraît plus que délicat de déterminer si tel ou tel prêt consenti par un trustee à un bénéficiaire du trust serait abusif ou non. Et aller voir l’administration pour lui demander son avis ne nous semble pas être la meilleure idée compte tenu de la conception qu’a cette dernière des trusts et sa connaissance au demeurant limitée du droit trustal.
La seule bonne nouvelle, c’est que la question est maintenant pendante devant le juge de l’impôt et que dans quelques années, nous devrions y voir plus clair…