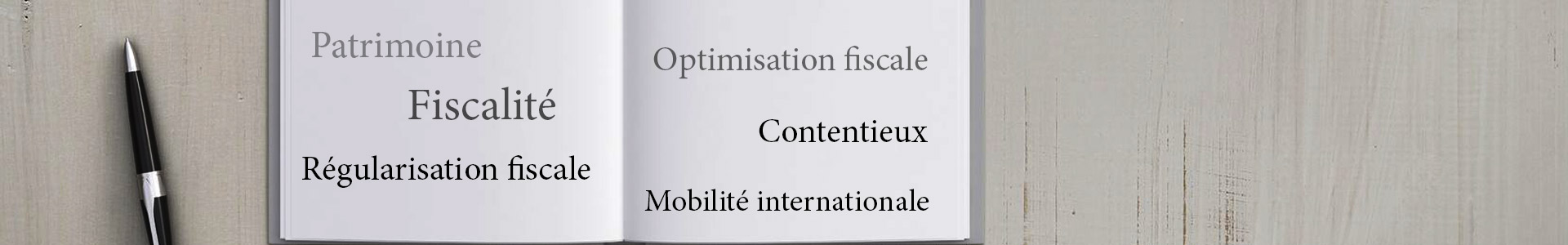Comptes Étrangers Non Déclarés : La Cour de cassation refuse d’interroger la CJUE
(Cass. com. 17 septembre 2025, n° 23-10.403)
On se souvient que la question de la conformité de la taxation au taux de 60 % du solde le plus élevé au cours des 10 dernières années d’un compte étranger non déclaré régulièrement soulevait des questions de conformité avec la liberté communautaire de circulation des capitaux (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2022/02/comptes-etrangers-non-declares-et-presomption-dacquisition-a-titre-gratuit-le-salut-viendra-t-il-de-leurope/).
On se souvient aussi que le tribunal judiciaire de Nanterre avait saisi la CJUE d’une question préjudicielle (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2024/05/article-755-du-cgi-et-imprescribilite-le-tj-de-nanterre-saisit-la-cjue-dune-question-prejudicielle/), mais que la mauvaise rédaction de la question posée avait entraîné son irrecevabilité (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2025/04/articles-l-23-c-du-lpf-et-755-du-cgi-la-question-prejudicielle-posee-par-le-tj-de-nanterre-jugee-irrecevable/).
Après la Cour d’appel de Versailles qui avait déjà rendu une décision de conformité particulièrement mal motivée (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2023/05/ompte-etranger-non-declare-et-article-755-du-cgi-la-cour-dappel-de-versailles-refuse-dappliquer-la-jurisprudence-europeenne/), c’était au tour de la Cour de cassation de se prononcer sur cette question, ce que sa chambre commerciale vient de faire le 17 septembre 2025.
Dire que cette décision satisfera les contribuables concernés relèverait de la litote, puisque non seulement la Cour a refusé d’interroger la CJUE, mais elle s’est prononcé pour la conformité de la combinaison des articles L 23 C du LPF et 755 du CGI avec la Liberté de circulation des capitaux.
La seule chose intéressante que contient cette décision est la reconnaissance que si le contribuable justifie de l’origine des sommes figurant sur le compte étranger non déclaré, alors la prescription redevient celle de droit commun. La question du caractère suffisant ou non des justificatifs produits par le contribuable sera en principe tranchée par les juges du fond mais on peut espérer que la cour régulatrice jouera pleinement son rôle en la matière, sachant que l’administration a pour sa part des exigences extrêmement strictes : elle n’hésite par exemple pas à considérer comme insuffisantes des réponses faisant valoir que les avoirs ont été hérités lorsqu’elles ne sont pas corroborées par des actes notariés.
Quels recours reste-t-il donc encore aux contribuables concernés pour que cette question soit enfin jugée par la CJUE ?
Ils peuvent saisir la Commission Européenne d’une demande de dépôt par cette dernière d’une plainte contre la France pour manquement à ses obligations résultants des textes européens. C’est cette procédure qui a permis de briser la jurisprudence du Conseil d’Etat qui interprétait les conséquences de la non-conformité du précompte avec la Directive « Distributions » de manière trop étroite (CJUE, 4 octobre 2018, aff. C-416/17).
Toutefois, les temps ont depuis changé et la Commission Européenne a d’autres chats à fouetter que de harceler les Etats-membres avec ce genre de considération qui ne concernent pas la fiscalité des grandes entreprises. Notre expérience de ces demandes ne nous rend guère optimiste.
Ils peuvent continuer à demander aux juges du fond de poser une Question Préjudicielle mais compte tenu de la décision rendue par la Cour de cassation, les chances d’assister à une rebellion paraissent d’autant plus faibles que la CJUE a jugé la Question Préjudicielle posée par le TJ de Nanterre irrecevable.
Reste une dernière voie qui présente, elle, de réelles chances de succès : saisir la Cour Européenne des Droits de l’Homme d’une demande de condamnation de la France pour violation de l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme relatif au caractère équitable du procès. En effet, contrairement à ce que semblent considérer nos deux cours suprêmes, la Question Préjudicielle n’est pas une option dont elles peuvent disposer à leur guise : il résulte en effet de l’article 267 du TFUE qu’elle est en principe obligatoire pour les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours en droit interne.
Selon la CJUE (6 octobre 1982, affaire 283/81, CILFIT), la dispense de saisine ne s’applique que :
- si la question soulevée n’est pas pertinente,
- si la dispositions communautaire en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour,
- ou si l’application correcte du droit communautaire s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, le tout après prise en compte du risque de divergences de jurisprudence à l’intérieure de l’Union.
Or, force est de constater que ces conditions ne sont absolument pas remplies et qu’au contraire, l’existence de la décision rendue par le juge européen condamnant l’Espagne pour une mesure proche laissait place un doute plus que raisonnable quant à la conformité du dispositif français.
Il est donc probable que si elle est saisie de ce point, la CEDH rendra une décision de condamnation qui obligera alors la Cour de cassation (ou les juges du fond) à saisir la CJUE d’une Question Préjudicielle.
Nous avons constaté que fort heureusement, la CEDH statuait dans un délai de seulement 2-3 ans, donc tous les espoirs sont permis pour que cette question soit enfin traitée au niveau qu’elle mérite.